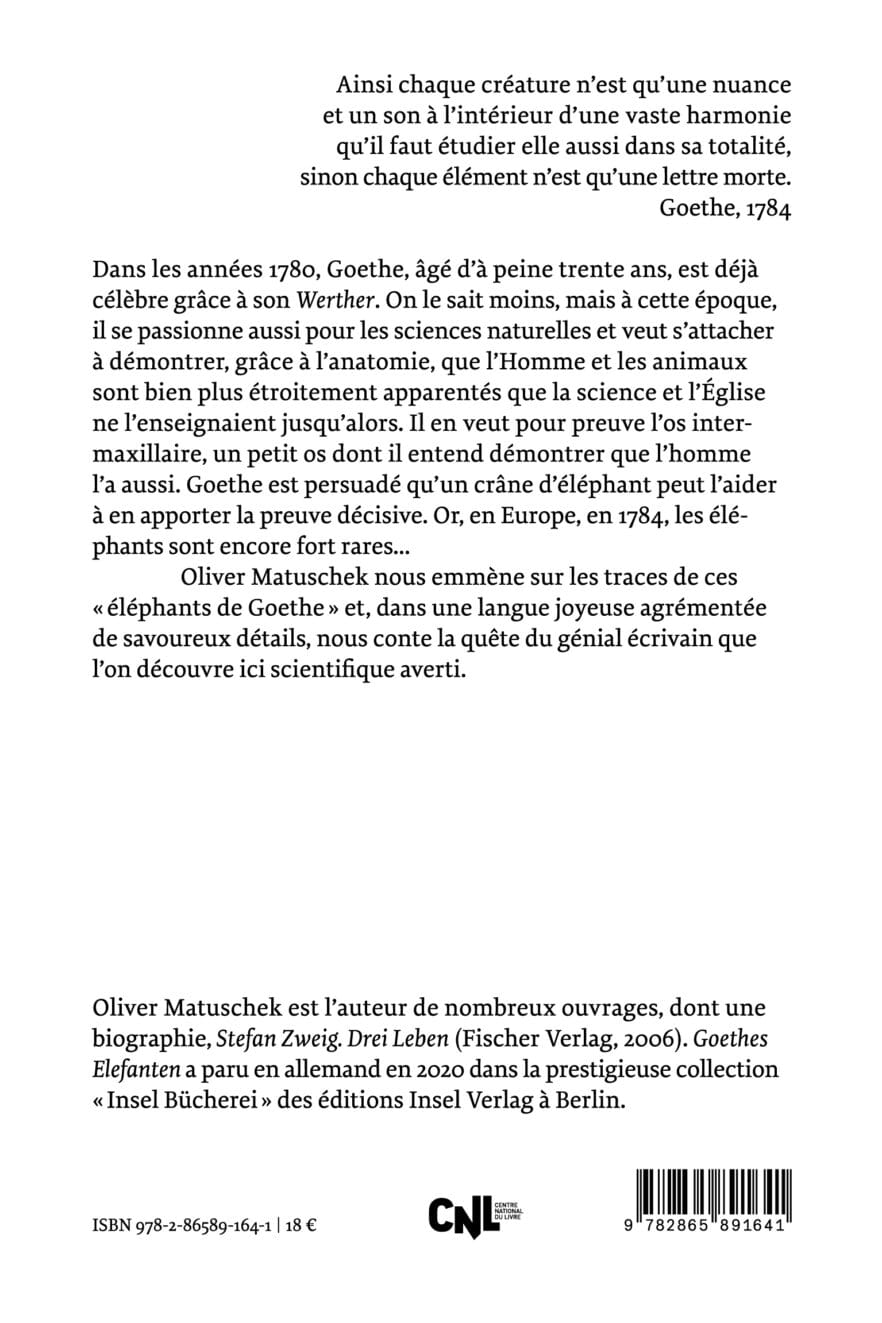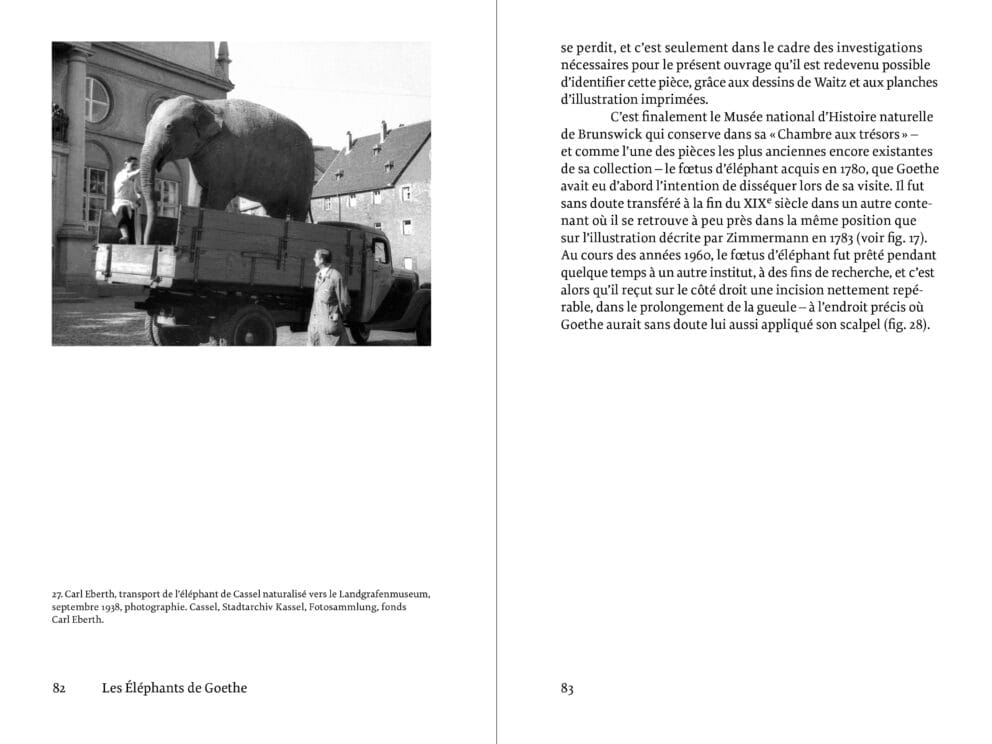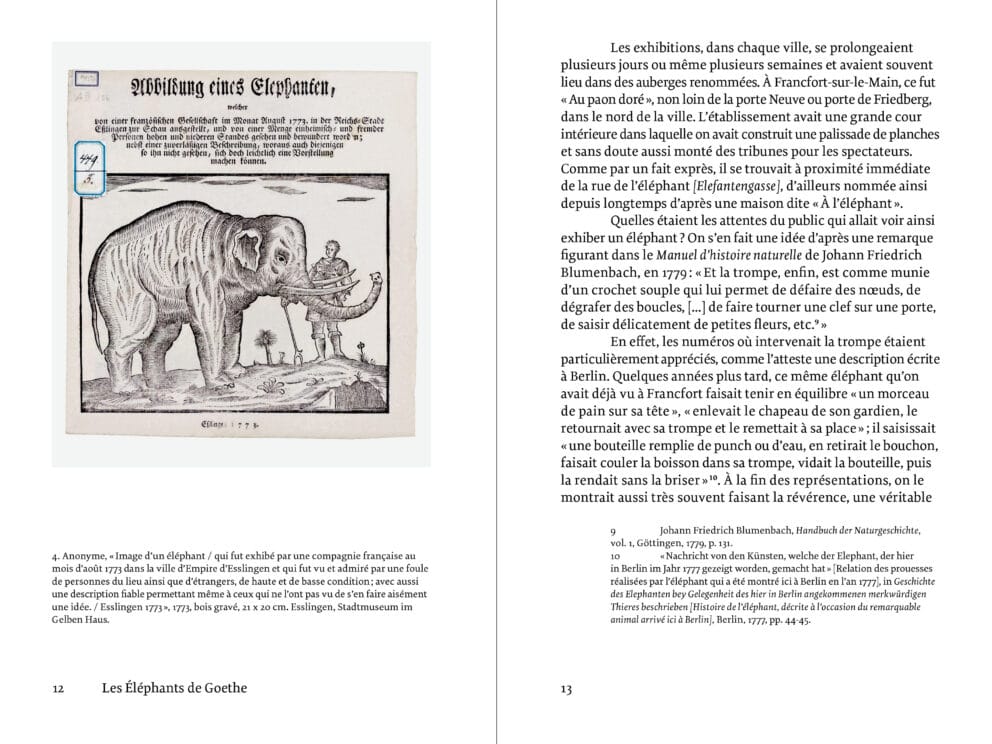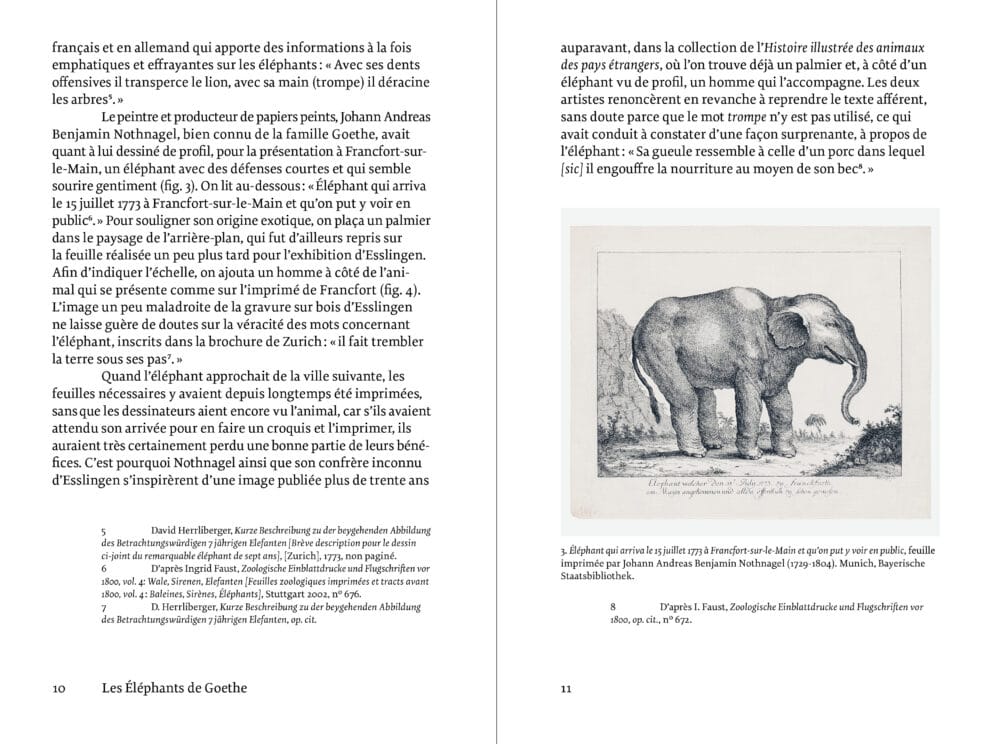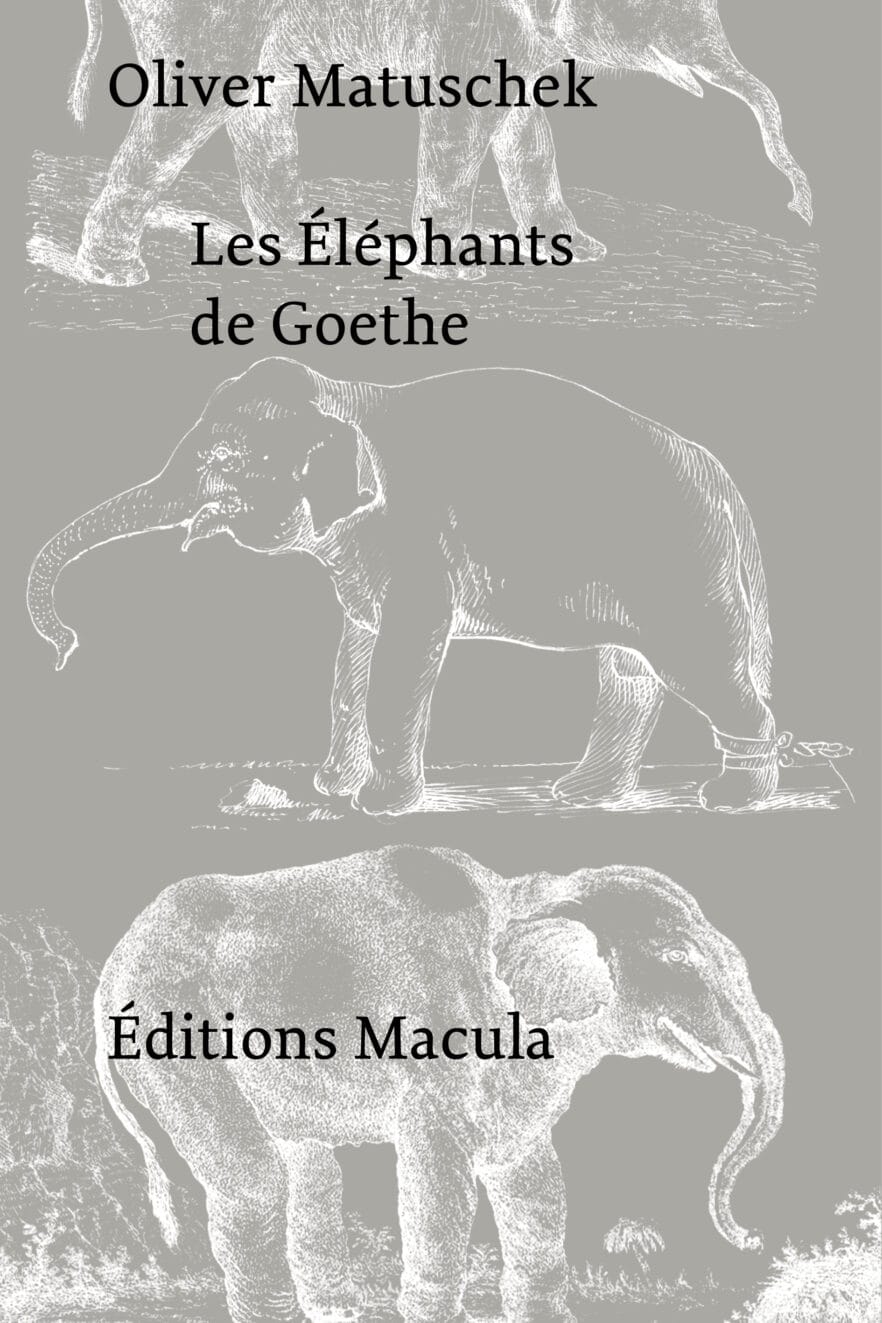Les Éléphants de Goethe
En librairie le 5 février 2025
« Ainsi chaque créature n’est qu’une nuance et un son à l’intérieur d’une vaste harmonie qu’il faut étudier elle aussi dans sa totalité, sinon chaque élément n’est qu’une lettre morte. » Goethe, 1784
Dans les années 1780, Goethe, âgé d’à peine trente ans, est déjà célèbre grâce à son Werther. On le sait moins, mais à cette époque, il se passionne aussi pour les sciences naturelles et veut s’attacher à démontrer, grâce à l’anatomie, que l’Homme et les animaux sont bien plus étroitement apparentés que la science et l’Église ne l’enseignaient jusqu’alors. Il en veut pour preuve l’os intermaxillaire, un petit os dont il entend démontrer que l’homme l’a aussi. Goethe est persuadé qu’un crâne d’éléphant peut l’aider à en apporter la preuve décisive. Or, en Europe, en 1784, les éléphants sont encore fort rares…
Oliver Matuschek est l’auteur de nombreux ouvrages, dont une biographie, Stefan Zweig. Drei Leben (Fischer Verlag, 2006). Goethes Elefanten a paru en allemand en 2020 dans la prestigieuse collection « Insel Bücherei » des éditions Insel Verlag à Berlin.
Dans la presse
« Goethe vit dans ce petit os partagé “la clé de voûte de l’édifice humain”, découverte qui lui fit même écrire en 1784 à sa confidente Charlotte von Stein : “J’en ai une telle joie que cela me remue jusqu’au fond des entrailles”… Un livre qui a l’éclat d’un tel eurêka.» Télérama, TTT, Juliette Cerf
« Un savoureux hommage au génie d’un homme » Le Monde des livres, Florent Georgesco
« Un petit livre limpide de 85 pages joliment écrites (et excellemment traduites), qu’on lit comme une palpitante enquête. » Revue des Deux Mondes, Eryck de Rubercy
« Une quête racontée en détail, et avec tout son contexte, par Oliver Matuschek » Pour la Science, Loïc Mangin
1839. Daguerre, Talbot et la publication de la photographie
Paris, 7 janvier 1839. L’homme politique et célèbre scientifique François Arago fait une communication devant l’Académie des sciences à propos d’un nouveau procédé, inventé par Louis Daguerre, qui permet de fixer les images se formant au foyer d’une chambre obscure. Immédiatement, le monde tend l’oreille et en quelques jours, avant que quiconque ait eu l’occasion de voir un daguerréotype, la nouvelle selon laquelle la science permet désormais de reproduire la nature se répand d’un bout à l’autre de l’Europe et atteint l’Amérique. Pris de vitesse, William Henry Fox Talbot qui, en Grande-Bretagne, a produit ses premiers « dessins photogéniques » quelques années auparavant, s’empresse alors de rendre son procédé public.
À partir de cette date, de nombreux acteurs, qu’ils soient savants, journalistes, artistes ou voyageurs, contribuent à inventer des métaphores, établir des comparaisons, forger des concepts et élaborer des raisonnements – en bref à instituer les canons et les cadres de référence du discours sur la photographie.
Cette anthologie se concentre sur les écrits provenant des deux pays d’origine des premiers procédés photographiques, la France et la Grande-Bretagne, et rédigés en cette année 1839 ou juste avant. Des textes parus dans l’espace germanophone et aux États-Unis les complètent, attestant ainsi la rapide diffusion de la photographie et de son discours.
Le lecteur découvre la profusion des motifs et des intérêts, des attentes et des promesses, des espoirs et des craintes qui se sont attachés à ce nouveau médium au moment de sa révélation au public.
Steffen Siegel est professeur de théorie et d’histoire de la photographie depuis 2015 à la Folkwang Universität der Künste d’Essen. Pendant l’année 2019-2020, il est Ailsa Mellon Bruce senior fellow à la National Gallery of Art de Washington, D.C. Parmi ses nombreuses publications, citons : Fotogeschichte aus dem Geist des Fotobuchs, Göttingen, 2019 ; Gegenbilder. Counter-Images, Vienne, 2016.
Carnet 9. Allemagne & Varia
« Marburg – grès rouge – bois –
Entre la Lahn & la Schwalm (Fulda), ni
mgnes ni tunnels, mais pays très boisé peu
habité.
Cassel et Wilhelmshöhe
jolie vallée de la Fulda jusqu’au
bassin de Münden.
Prairies de la vallée de la Leine ;
on ramasse les foins, beaucoup de
femmes travaillent ; aspect gai de
la campagne.
Hannover – 12-13 7bre, t.à.f. en
plaine – type de gde ville
du Nord ; beaux quartiers neufs. »
Telle est donc la matière de ce livre : la notation à l’état sauvage dans la plus civilisée des attitudes. Un voyageur visite un pays alors ennemi, nous sommes en 1885-1886, et il note ce qu’il voit et ce qu’il devine il se déplace en train, il cherche à comprendre, à caractériser, il est en route aussi vers lui-même et vers le très grand géographe qu’il sera, qu’il est déjà sans doute.
Des circonstances d’écriture et des raisons d’être de ce Carnet 9 consacré principalement à l’Allemagne et prélevé dans le corpus des 33 carnets de Paul Vidal de la Blache conservés à la Bibliothèque de l’Institut de Géographie de Paris, le commentaire critique attentif et précis de Marie-Claire Robic et Jean-Louis Tissier répond, et c’est ainsi une très précieuse archive qui nous est transmise avec un soin extrême, et qui nous procure la surprise de pouvoir lire aussi ces traces d’une pensée en devenir comme une sorte de poème matériel porté par la joie de nommer.
L’Atelier de Courbet
L’Atelier du peintre de Courbet, tableau somme où vient se résumer le siècle, écrit Werner Hofmann. Et quel siècle ! Hirsute, désaccordé, en allé d’un bout à l’autre dans les luttes, les combats, les conflits. Rien qui échappe à ce fabuleux tourbillon. La politique, la pensée, les arts, tout est versé à l’alambic bouillonnant où s’invente et se distille « la vie moderne », théorisée par Baudelaire. Dans ce laboratoire, le peintre est à l’ouvrage, Courbet est à l’œuvre.
On ne veut pas de son Atelier à l’Exposition universelle de 1855 ? Qu’importe. En marge de la grande foire où le monde s’enivre au miroir des inventions et des conquêtes de la technique, Courbet fera bâtir son propre « Pavillon du Réalisme », inaugurant dans ce geste la profession d’indépendance de l’artiste, qui n’entend plus se soumettre à aucun jury : seul son bon vouloir, son goût, ses lubies décideront désormais.
Se plantant devant la grande toile de Courbet, Werner Hofmann se souvient de la leçon de Cézanne, giflé par La Vague de Berlin : « On la reçoit en pleine poitrine. On recule. Toute la salle sent l’embrun. » « Allégorie réelle », dit le peintre à propos de son Atelier, et l’historien de l’art ne manquera pas de le prendre au mot. Sur la pente malcommode de l’oxymore, la pensée rebondit et cesse de penser contradictoirement. Dissonance, tel pourrait être ici le maître mot d’une énigme ouverte et sans solution. Et si Hofmann convoque Marx, Flaubert, Rimbaud, mais aussi le régime polyfocal des retables médiévaux et jusqu’aux surréalistes, c’est pour mieux cerner l’inquiétude que L’Atelier du peintre a creusée en effet « au pivot du siècle », comme l’écrit Stéphane Guégan dans sa préface. Inquiétude ou vacillement dont il ne sera pas dit que nous soyons tout à fait revenus.
L’historien de l’art Werner Hofmann (1928-2013) est l’un des derniers représentants de l’école de Vienne, où il fonde en 1962 le Musée du XXe siècle, l’actuel Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig (mumok). De 1969 à 1990, il dirige la Kunsthalle de Hambourg et y présente des expositions qui font date (Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge ou Francisco de Goya, et des artistes contemporains comme Joseph Beuys ou Georg Baselitz). Passionné par le XIXe siècle, Werner Hofmann s’est appliqué dès son premier livre, Le Paradis terrestre (1960), et pendant toute sa vie à en scruter le formidable champ de tension, prêtant une attention particulière à la modernité française et à ses figures cardinales, Courbet, Degas ou Daumier.
Stéphane Guégan, historien de l’art, est conseiller scientifique auprès de la Présidence du musée d’Orsay. Spécialiste du romantisme français, il est notamment l’auteur d’ouvrages sur Gautier, Delacroix et Ingres, mais aussi Gauguin, Picasso et Derain. Aux éditions Flammarion, il a créé la collection des ABCdaires. Son nom est aussi lié au commissariat de plusieurs expositions remarquées, dont Manet, inventeur du Moderne (Paris, musée d’Orsay, 2011).
Écrits sur l’art
August Strindberg (1849-1912) a non seulement mis à jour la violence des sentiments et la cruauté des mots dans son théâtre, ses romans mais il a aussi oeuvré en peintre et en critique d’art. Dans ses tableaux, d’où l’humain est banni, une nature sauvage, rude emplit la toile. Rien de joli, d’aimable. Une matière étalée au couteau qui magnifie les éléments de la nature face à l’homme et qui le renvoie à son insignifiance. Une déclinaison de tonalités, une symphonie de couleurs. L’intérêt de Strindberg pour la peinture se double d’un travail de critique. Un oeil perspicace avec une connaissance de la scène artistique nordique et une curiosité pour ce qui se passe ailleurs en Europe.
Formé par des cours d’esthétique à l’Université d’Uppsala, il étudie avec méthode les différentes théories esthétiques, lit ce qui est publié, se frotte aux classiques. Il s’intéresse à ce que produisent ses contemporains. Et subit l’attraction de Paris. Il y séjourne à plusieurs reprises, fréquente les cercles artistiques, découvre les impressionnistes naissants. Sa connaissance parfaite de la langue française qu’il pratique et écrit lui permet d’être publié sur place. Il voyage en Allemagne, en Suisse. Compare les peintres suédois influencés par l’école française, celles de Düsseldorf, de Munich. Et s’élabore peu à peu un corpus d’articles mettant en opposition la peinture française, produit du climat tempéré à une peinture suédoise, nordique plus âpre, plus rude. Aussi Strindberg développe une curiosité pour l’expérimentation photographique, nouveau média dont il comprit tout de suite les possibilités et comment les explorer grâce à son intérêt pour la chimie. À certaines périodes de sa vie, Strindberg éprouve un profond doute sur l’utilité sociale de toute activité artistique. Ses convictions à la fois politiques et sociales alliées à une sévère misanthropie l’amènent à un rejet de toute expression. Mais perdurent ces textes, ces analyses, dont vingt-six sont à lire au sein du présent recueil.
Jean Louis Schefer, écrivain, philosophe et critique d’art, s’est imprégné de ces textes « écrits pour un public à éduquer et non pas à satisfaire » et en a tiré une préface éclairante, où la langue de Strindberg fait écho à la sienne. Par la richesse de sa pensée et de son lexique, il dégage toute la poésie des Écrits sur l’art de Strindberg.
Du romantisme au réalisme
Le XIXe siècle est devenu le champ clos où s’affrontent les historiens d’art. Les uns, les modernistes, sont partisans d’une analyse formelle qui prend son départ dans l’œuvre même ; les seconds, les révisionnistes, ont entrepris de bouleverser la généalogie de la peinture, soit pour y réintroduire les courants officiels et mondains (académisme, pompiers), soit pour faire du contexte social et particulièrement de la commande (officielle ou privée) le moteur de la production artistique.
Si opposés soient-ils, ces deux courants se réfèrent d’abondance au livre fondamental publié par Léon Rosenthal en 1914. Du Romantisme au Réalisme traite à la fois des conditions sociales de la production culturelle entre 1830 et 1848 – rôle de Louis-Philippe et de l’idéologie nationale, résistances de l’Institut, expansion des Salons, querelles d’ateliers – et des qualités esthétiques qui ont fait de Delacroix, d’Ingres, de Chassériau les phares de l’École française.
Dans une analyse qui va jusqu’au détail de la couche et de la touche, l’auteur définit les grands courants du siècle : romantique, « abstrait » (Ingres) et « juste-milieu ». C’est Rosenthal qui mit en circulation cette dernière notion pour situer Horace Vernet, Delaroche, et les divers tenants d’un compromis historique entre les tendances majeures du moment.
D’autres chapitres sont consacrés au triomphe du paysage et aux précurseurs de l’impressionnisme, à la renaissance de la peinture monumentale, qui jouit d’un âge d’or avec Delacroix, Chassériau, Flandrin, etc. – enfin à la recherche d’une peinture démocratique, voire édifiante, qui préfigure et accompagne la révolution de 1848.
Dans son introduction, Michael Marrinan, depuis 2004 professeur d’histoire de l’art à l’Université de Stanford, Californie, rend justice au précurseur que fut Rosenthal.
Né en 1870, mort en 1932, agrégé d’histoire, directeur des musées de Lyon, Léon Rosenthal a notamment publié un David, un Géricault, un Daumier et un manuel sur la gravure.
La Photographie en France
La photographie est l’une des grandes inventions du XIXe siècle. Elle a suscité une multitude d’écrits, dès les premiers tâtonnements de Niépce en 1816. Ces documents écrits sont de toutes première importance pour connaître la photographie dans ses dimensions esthétiques, techniques, sociales, économiques et idéologiques ; pour aborder d’un point de vue original la science, l’industrie, la communication, et l’art lui-même qui a été profondément ébranlé par cette « intruse ».
L’ouvrage d’André Rouillé n’est pas une simple juxtaposition de textes, mais une mise en sens des écrits, des propos et des positions. Il rend compte de façon claire et précise des controverses dont la photographie a été l’objet au cours de ces cinquante dernières années. Jamais un tel ensemble de textes fondamentaux, inédits ou inaccessibles, n’avait été établi.
Cet ouvrage est conçu comme un instrument de travail. Il est précédé d’une introduction générale. Les 200 textes, accompagnés de leurs références précises, sont présentés et replacés dans leur contexte.
L’importance des annexes facilite l’étude, la recherche, la découverte :
1 : un glossaire des principaux procédés techniques et un tableau chronologique de leur période d’utilisation
Les Démoniaques dans l’art
Charcot n’a pas seulement ouvert la voie à la psychanalyse freudienne par le biais de l’hypnose et de la clinique. Il a aussi interprété des tableaux, élaboré une esthétique.
Les Démoniaques dans l’art, publié en 1887 – jamais réédité, introuvable aujourd’hui – constitue le tout premier ouvrage où l’histoire de l’art a été scrutée par l’œil d’un médecin des névroses. C’est dans les grandes scènes de possession démoniaque et de guérisons miraculeuses – peintes par Andrea del Sarto, Raphaël, Rubens et bien d’autres – que Charcot a retrouvé la forme même de l’hystérie, quelquefois dans sa plus fine précision clinique.
Mais à travers ce regard nouveau porté sur les images, Charcot propose en même temps une interprétation pathologique des phénomènes de la possession, de l’extase, du miracle. La Foi qui guérit (1892), considéré comme le « testament philosophique » de Charcot, esquisse une véritable théorie du miracle thérapeutique – question qui n’a rien perdu de son actualité, tant dans la sphère religieuse que dans la sphère médicale.
Invention de l’hystérie
Ce livre raconte et interroge les pratiques qui se firent jour à la Salpêtrière, du temps de Charcot, autour de l’hystérie.
À travers les procédures cliniques et expérimentales, à travers l’hypnose et les « présentations » de malades en crise (les célèbres « leçons du mardi »), on découvre l’espèce de théâtralité stupéfiante, excessive, du corps hystérique. On la découvre ici à travers les images photographiques qui nous en sont restées, celles des publications, aujourd’hui rarissimes, de l’Iconographie photographique de la Salpêtrière.
Freud fut le témoin de tout cela, et son témoignage devint la confrontation d’une écoute toute nouvelle de l’hystérie avec ce spectacle de l’hystérie que Charcot mettait en œuvre. Témoignage qui nous raconte les débuts de la psychanalyse sous l’angle du problème de l’image.
Le Retour de Rodin
Jusqu’au milieu des années cinquante, l’œuvre de Rodin était surannée pour un regard moderne. On ne connaissait presque de lui que ses marbres sirupeux. Or voici qu’un livre américain a transformé le regard qu’on portait sur le célèbre sculpteur français. Avec Steinberg, le retour que Rodin effectue dans le giron de la modernité est définitif. Oubliez les marbres, commence-t-il par dire : la plupart ne sont même pas de la main du sculpteur mais taillés par des artisans à sa solde, certains même sont posthumes. Laissez de côté la production sentimentale de Rodin entrepreneur, la partie visible et commerciale de l’iceberg, et regardez le sculpteur au travail. Fragmentation et multiplication, combinaison et inversion, distorsion et déplacement : Rodin est un structuraliste avant la lettre, décomposant et recomposant les membra disjecta du corps humain comme autant d’éléments propres au langage de la sculpture.
De ce que l’on considérait jusqu’alors comme le point terminal et grandiose de l’histoire de la sculpture du dix-neuvième siècle, Steinberg fait ce qui ouvre celle de notre temps : Rodin redevient notre contemporain.
Leo Steinberg (1920-2011) a réalisé de nombreuses études sur Filippo Lippi, Mantegna, Léonard, Michel-Ange, Pontormo, Le Guerchin, Jan Steen, Vélasquez et Picasso. Outre La Sexualité du Christ dans l’art de la Renaissance et son refoulement moderne, traduit en français en 1987 (Gallimard), ses publications comptent une anthologie d’essais sur l’art contemporain (Other Criteria, 1972), une analyse des dernière œuvres picturales de Michel-Ange (1975) et du symbolisme trinitaire de Borromini (1977).