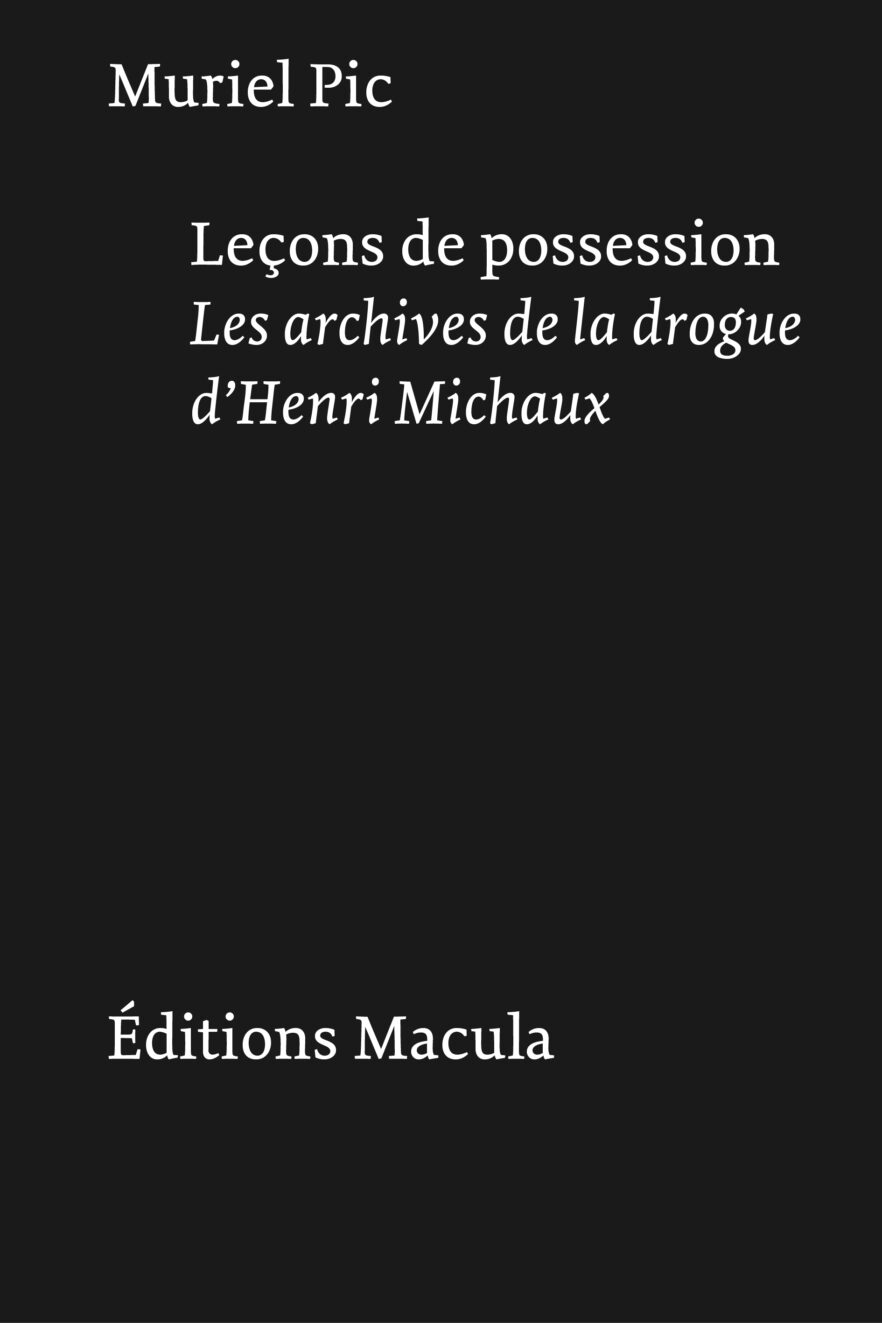Leçons de possession
Muriel Pic propose un texte inédit sur les expérimentations de drogues par Henri Michaux à l’époque où l’on inventait les médicaments psychotropes.
Henri Michaux (1899-1984), écrivain et peintre parmi les plus connus de sa génération, participe à partir de 1955 aux recherches sur les hallucinogènes conduites à l’échelle mondiale. Pendant des années, il va expérimenter diverses substances – haschich, mescaline, champignons, LSD – sous le contrôle et en collaboration avec l’hôpital Sainte-Anne, le Muséum d’histoire naturelle de Paris ou encore avec les laboratoires pharmaceutiques suisses Sandoz, qui produisent les molécules utilisées à des fins cliniques et thérapeutiques.
La révolution psychopharmacologique aboutit à l’invention de la médication psychotrope et au contrôle chimique du comportement. Cet événement majeur dans l’histoire des sciences est raconté ici du point de vue d’un artiste qui en fut à la fois le témoin et l’acteur.
Muriel Pic se fonde sur les archives inédites des expérimentations sous drogue de Michaux : des notes d’auto-observation d’un incomparable éclat poétique. À partir de ce matériau fascinant, l’ouvrage replace pour la première fois l’œuvre de Michaux dans son contexte en rappelant que ses textes et dessins nés de la folie volontaire ont d’abord été considérés par les médecins comme des documents scientifiques sur l’hallucination.
Cet ouvrage est richement illustré des dessins de Michaux créés sous influence et de nombreux documents issus de ses « archives de la drogue ».
Muriel Pic est docteure de l’EHESS, écrivaine et chercheuse, également réalisatrice, collagiste, traductrice de l’allemand. Elle a publié plusieurs essais sur Henri Michaux, W. G. Sebald, Walter Benjamin et Rosa Luxemburg. Citons parmi ses publications Affranchissements (Seuil, 2020) et Élégies documentaires (Macula, 2016).
Les Éléphants de Goethe
En librairie le 5 février 2025
« Ainsi chaque créature n’est qu’une nuance et un son à l’intérieur d’une vaste harmonie qu’il faut étudier elle aussi dans sa totalité, sinon chaque élément n’est qu’une lettre morte. » Goethe, 1784
Dans les années 1780, Goethe, âgé d’à peine trente ans, est déjà célèbre grâce à son Werther. On le sait moins, mais à cette époque, il se passionne aussi pour les sciences naturelles et veut s’attacher à démontrer, grâce à l’anatomie, que l’Homme et les animaux sont bien plus étroitement apparentés que la science et l’Église ne l’enseignaient jusqu’alors. Il en veut pour preuve l’os intermaxillaire, un petit os dont il entend démontrer que l’homme l’a aussi. Goethe est persuadé qu’un crâne d’éléphant peut l’aider à en apporter la preuve décisive. Or, en Europe, en 1784, les éléphants sont encore fort rares…
Oliver Matuschek est l’auteur de nombreux ouvrages, dont une biographie, Stefan Zweig. Drei Leben (Fischer Verlag, 2006). Goethes Elefanten a paru en allemand en 2020 dans la prestigieuse collection « Insel Bücherei » des éditions Insel Verlag à Berlin.
Dans la presse
« Goethe vit dans ce petit os partagé “la clé de voûte de l’édifice humain”, découverte qui lui fit même écrire en 1784 à sa confidente Charlotte von Stein : “J’en ai une telle joie que cela me remue jusqu’au fond des entrailles”… Un livre qui a l’éclat d’un tel eurêka.» Télérama, TTT, Juliette Cerf
« Un savoureux hommage au génie d’un homme » Le Monde des livres, Florent Georgesco
« Un petit livre limpide de 85 pages joliment écrites (et excellemment traduites), qu’on lit comme une palpitante enquête. » Revue des Deux Mondes, Eryck de Rubercy
« Une quête racontée en détail, et avec tout son contexte, par Oliver Matuschek » Pour la Science, Loïc Mangin
Les Couleurs du passé
Le passé nous échappe, nul qui puisse le rattraper ni le saisir pleinement. Avec l’éloignement et la mort, le passé est l’une des manifestations ordinaires de cette absence avec laquelle l’image a toujours partie liée. De cette défaillance de la représentation, le mythe de l’origine de la peinture, tel que rapporté par Pline, nous a livré le lumineux modèle : son fiancé s’apprêtant à partir pour la guerre, une jeune fille trace à la craie le contour de l’ombre projetée sur le mur par le visage aimé. Le caractère mimétique de l’image se double aussitôt d’une vertu consolante, en instituant un régime qui s’est déployé sans interruption jusqu’à nous, au point que l’on peut se demander si la jeune fille de Corinthe, en plus de la peinture, n’a pas inventé aussi la photographie et le cinéma avec sa lanterne magique.
Peinture, photographie, cinéma, à quoi viennent se joindre les dernières métamorphoses de l’image sous l’aiguillon des technologies numériques, tels sont les objets que Peter Geimer met ici à la question, en examinant les réussites, les dérives ou les échecs de ceux qui, représentant le passé, ont tenté d’en retenir et d’en ramener quelque chose dans le présent, en donnant ainsi forme à l’histoire. Qu’est-ce qu’un document visuel ? Qu’est-ce qu’une image d’archive et quels sont les usages qu’elle autorise ?
Attention sourcilleuse au détail authentique chez le peintre d’histoire Meissonier, immersion du spectateur dans les grands panoramas de bataille que le XIXe siècle a rêvés comme un spectacle total, photographies et films en noir et blanc qu’on colorise, qu’on anime ou qu’on sonorise dans l’illusion de les rendre enfin « plus vivants ». : de l’analyse de ces diverses pratiques, on conclura que loin de n’être qu’une simple illustration d’un événement historique, toute image est d’abord elle-même profondément enfoncée ou engoncée dans l’histoire. D’où la véridicité et la force de témoignage qui sont incorruptiblement les siennes, quelles que soient les couleurs dont certains, après coup, ont parfois voulu la parer.
Peter Geimer (1965) est directeur du Centre allemand d’histoire de l’art à Paris. Ses recherches portent sur la théorie et l’histoire de la photographie, la représentation visuelle de l’histoire et l’histoire des sciences. Auteur de nombreux ouvrages en allemand, dont a paru en français Images par accident. Une histoire des surgissements photographiques (Les presses du réel, 2018).
L’Apostrophe muette
Les portraits du Fayoum sont cette population silencieuse incarnée par des visages que les fouilles ont peu à peu fait sortir des tombeaux. Réalisés dans l’Égypte romaine des trois premiers siècles de notre ère, et relevant à la fois d’une tradition mimétique grecque et d’un accompagnement rituel proprement égyptien, ils n’étaient pas destinés à être vus. Mais depuis qu’ils ont été retrouvés et identifiés, ils n’ont cessé de fasciner. Dispersée à travers le monde, leur énigme reste intacte, nous sommes avec eux devant un seuil : depuis le côté de la mort où ils ont basculé ils nous regardent, les yeux ouverts, comme s’ils étaient vivants. Du coup, via leurs noms, leurs parures, et comme sortis du réseau de bandelettes entourant les momies où ils étaient encastrés, ils nous renvoient à tout un monde qui n’existe plus et qui fut le leur. Avec eux c’est toute l’histoire du portrait et sa relation à la mort qui s’inaugure, dans une douceur étrange et insistante.
Passionné par ces visages, Jean-Christophe Bailly, a tenté, tout en reconstituant l’atelier de pensées qui les a libérés, de rendre transparente la relation que nous pouvons désormais avoir avec eux. La présente édition reprend celle publiée en 1997 par les éditions Hazan en lui ajoutant une préface qui souligne l’actualité sans fin reconduite de cet exceptionnel moment où plusieurs civilisations méditerranéennes se sont rencontrées autour d’images qui furent d’abord des gestes d’observance.
Âmes primitives
C’est donc un livre de cinéma ?
Pas exactement, ou pas seulement, même s’il s’agit beaucoup d’images animées ou d’animation. Il y est aussi question de dessin et de jouets, de transe, de rêve, de spectres, d’union et de désunion de l’âme et du corps…
Un livre d’histoire de l’art alors, ou d’anthropologie, ou de philosophie ?
Pas plus, même si j’emprunte à tous ces discours pour raconter une histoire, qui est au fond l’histoire de toutes les histoires : celle de la transformation du corps en figure et de son entrée dans la représentation dont j’essaie de retrouver les traces disparates dans l’univers de Krazy Kat ou de Little Nemo, dans le cinéma burlesque ou scientifique, dans les danses de possession en Italie du sud ou dans les mythologies indiennes…
Et pourquoi Âmes primitives ?
Les âmes primitives, ce sont les âmes séparées, comme le sont les figures. Car pour qu’une figure apparaisse, il faut qu’un corps disparaisse et la figurabilité en tant que telle est un récit de séparation. C’est pour cela que la question de la représentation a partie liée au deuil et que le deuil, à l’inverse, nous renvoie toujours à l’énigme de la représentation.
Écrits choisis des années 1940 & Art et Culture
Clement Greenberg (1909-1994) est une figure essentielle de la critique d’art au XXe siècle. Dire que son premier article, « Avant-garde et kitsch », paraît dans une revue new-yorkaise de gauche à l’automne 1939, alors que le jeune homme rentre d’un voyage dans une Europe sous très haute tension, c’est planter le décor où sa réflexion esthétique s’est façonnée et va bientôt s’affirmer : l’art du vieux continent d’un côté, de l’autre les courants qui se feront jour aux États-Unis après la guerre. Dialogue ou confrontation, le critique ne cessera d’en scruter les tenants et les aboutissants, le jeu complexe des influences, des dépassements, des continuités, des ruptures.
Pour élaborer sa pensée, Greenberg dispose de deux outils formidablement acérés : un regard et une écriture. Sa capacité à traduire avec tant d’exacte justesse ce que son œil sait voir continue d’étonner. Aussi représente-t-il, plus que ses rivaux Alfred Barr, Harold Rosenberg ou Meyer Schapiro, l’emblème du « formalisme américain ». Mais le portrait ne serait pas complet si l’on n’y ajoutait un goût certain pour la dispute. Cette pugnacité, le critique la met au service d’une cause dont il devient le champion : l’art abstrait, tel qu’il surgit sur la scène new-yorkaise dans les années 1940 et 1950, incarné au premier chef par Jackson Pollock en peinture ou David Smith en sculpture. L’importance de Greenberg est donc historique : il est à la fois l’observateur et l’artisan de la bascule qui s’opère à ce moment-là, Paris cédant à New York sa place de capitale artistique mondiale.
En 1961, Greenberg reprend trente-sept de ses essais pour les publier en recueil. Art et Culture met la dernière touche à son image de censeur aux jugements incisifs, péremptoire et arrogant. Le livre suscite un débat passionné et l’on se définira désormais pour ou contre Greenberg, qu’il s’agisse des critiques qui en récusent (Rosalind Krauss) ou en recueillent (Michael Fried) l’héritage, ou des tendances qui se dessinent alors aux États-Unis, art minimal, conceptuel ou Pop Art. Le volume paraît en français en 1988, aux éditions Macula.
En donner aujourd’hui une nouvelle édition augmentée et annotée, c’est d’abord vouloir nuancer cette représentation exagérément rigide. Les Écrits choisis des années 1940 nous font voir une pensée en gestation, ouverte aux repentirs, soucieuse d’affiner son vocabulaire et ses concepts. Greenberg, qui s’est toujours proclamé autodidacte, n’hésite pas à réviser sa copie. C’est ce que montre avec brio l’appareil critique de Katia Schneller, qui révèle, au prix d’une analyse comparative minutieuse, tout ce que l’édifice greenbergien doit à l’exercice du doute. En résulte une image insolite, plus subtile mais toujours vigoureuse : celle d’un intellectuel enthousiasmant et volontiers batailleur.
Katia Schneller est docteure en histoire de l’art, professeure d’histoire et théorie des arts à l’ÉSAD – Grenoble – Valence et chercheuse associée à l’HiCSA de l’université Paris I – Panthéon | Sorbonne, l’EA1279 de Rennes 2 et le CERCC de l’ENS de Lyon. Une partie de ses recherches porte sur l’art et la critique d’art des États-Unis de la seconde moitié du XXe siècle. Elle a publié Robert Morris sur les traces de Mnémosyne (Paris, ENS LSH / Éditions des Archives contemporaines, 2008) et a été codirectrice des ouvrages Au nom de l’art, enquête sur le statut ambigu des appellations artistiques de 1945 à nos jours (Paris, Publications de la Sorbonne, 2013), Investigations, ‘Writing in the Expanded Field’ in the Work of Robert Morris (Lyon, ENS éditions, 2015) et Le Chercheur et ses doubles (Paris, B42, 2016). Elle est cofondatrice de la plateforme de recherche « Pratiques d’hospitalité ».
Muralnomad
Le Corbusier disait de ses tapisseries qu’il avait baptisées » Muralnomad » qu’elles pouvaient » se décrocher du mur, se rouler, se prendre sous le bras à volonté, aller s’accrocher ailleurs ». Il décrivait ainsi parfaitement le paradoxe de l’œuvre murale : destinée au mur et à la permanence, elle en fut, par tous les moyens, éloignée.
Rares sont les historiens à avoir étudié les œuvres murales entre les années 1920 et les années 1950 par le biais de leurs relations aux autres pays. Romy Golan adopte ce regard transnational qui, tout en se concentrant sur la France et l’Italie, intègre ces deux pays à une histoire transnationale du médium – l’Espagne, l’Allemagne, l’Union soviétique, le continent américain et l’Inde. L’auteur, plutôt que de se contenter d’une étude exhaustive, s’est focalisée sur une série d’objets fascinants qui l’amènent à repenser la distinction entre art, architecture et décoration, ainsi que les relations entre art et politique.
Certaines œuvres murales que nous propose Romy Golan sont aussi curieuses qu’une mosaïque démontable, qu’une toile peinte destinée à ressembler à une photographie, qu’une tapisserie que l’on rêve mur de laine portatif. D’autres sont des icônes. C’est le cas des Nymphéas de Monet, grandes toiles que le peintre avait voulues inamovibles, marouflées directement sur les murs. On les découvre pourtant délaissées des décennies durant dans une Orangerie qui prend l’eau, objets de critiques qui les décrivent comme propices à la claustrophobie, à la » désorientation », et qui assimilent l’Orangerie à un mausolée-bunker. Par une lecture innovante qui fait appel à Freud et à ses concepts de sentiments océaniques et de traumatisme, Romy Golan les relie aux panoramas de champs de bataille.
Autre icône : Guernica, la fresque de Picasso peinte pour le pavillon espagnol à l’Exposition universelle de 1937 à Paris. On croit tout savoir d’elle, mais Romy Golan la replace dans le bâtiment républicain espagnol, parmi les nombreux photomurals vantant les bienfaits du Frente popular, et en s’appuyant sur Walter Benjamin et sa théorie du montage nous en découvre tout un pan que l’œil d’aujourd’hui ne pouvait saisir : ce que Guernica doit au montage photographique, avec pour exemple ses tons de noir et de blanc, son style » couper-coller » et sa fonction assumée d’agit-prop.
Romy Golan regarde aussi vers l’Italie, autre grand pays de l’œuvre murale, » sœur latine » de la France – deux sœurs brouillées lors de la période mussolinienne. En 1937, l’Italie s’exporte à Paris pour l’Exposition universelle, et la grande mosaïque de Mario Sironi, Il lavoro fascista, exposée à l’origine à la Triennale de Milan de 1936, est déplacée dans la capitale française : alors qu’une mosaïque devrait par principe être inamovible, celle-ci est aisément démontable et transportable. À Paris, son mode d’exposition, que l’on doit à l’architecte Giuseppe Pagano, est inédit : la mosaïque est suspendue au milieu de la salle, avec un accès privilégié à sa face cachée (son dos). Romy Golan recourt à l’École viennoise d’histoire de l’art et à Alois Riegl et montre ce que cette œuvre doit aux ruines romaines, notamment à l’arc de Constantin édifié à l’aide de spolia, et comment l’œuvre questionne le concept de romanité du régime mussolinien.
L’Exposition universelle de 1937 à Paris tient une grande place dans ce livre. Dans l’Europe des années 1930, les œuvres murales sont des instruments politiques au service des régimes, qu’ils soient de droite ou de gauche. Allemagne nazie, Italie fasciste, Union soviétique, France du Front populaire, République espagnole, tous ont usé de l’œuvre murale sous toutes ses formes. Mais étonnamment, à l’Exposition universelle de 1937, les fascistes italiens, les nazis et les Soviétiques préférèrent les médiums traditionnels de la peinture et de la sculpture, alors que les montages photographiques des artistes français affiliés à la gauche, dont Fernand Léger, Charlotte Perriand, Lucien Mazenod, célèbrent la vie rurale et le travail à l’usine.
Romy Golan conclut sur les tentatives française et italienne de produire une synthèse des arts. Si en Italie, la décoration forme désormais un supplément – au sens de Derrida – au bâtiment, avec les artistes Lucio Fontana, Mario Radice, Gianni Dova, en France, c’est la tapisserie qui, héritière de la Résistance et des ateliers clandestins d’Aubusson, se réinvente avec notamment les œuvres tissées de Jean Lurçat (La Liberté, ou encore son cycle tiré de l’Apocalypse d’Angers). La tapisserie se réinvente si fortement qu’elle part en tant que » muralnomad » dans les bagages de Le Corbusier pour la ville nouvelle de Chandigarh.
Ce livre, avec son iconographie unique riche de 175 illustrations, pour la plupart en couleurs, est une invitation à se plonger dans l’Europe des années 1920 aux années 1950, une période englobant la Seconde Guerre mondiale qui, dans le cas présent, ne fait pas office de rupture, mais est considérée dans sa continuité.
Romy Golan est professeur d’histoire de l’art du XXe siècle au Graduate Center, City University of New York. Parmi ses publications : Modernity and Nostalgia: Art and Politics in France Between the Wars (Yale University Press, 1995). Elle a récemment étudié les temporalités cachées de l’art italien dans les années 1960 et en a publié les résultats dans les revues Grey Room, October et Transbordeur.
Les Papiers de Picasso
Picasso avait travaillé dur pour l’exposition de 1919 chez son nouveau marchand, Paul Rosenberg – sa première exposition personnelle en treize ans, partagée entre œuvres cubistes et dessins néoclassiques. Et voilà qu’un critique comme Roger Allard n’y reconnaît qu’une succession de pastiches historiques : « Tout, y compris Léonard, Dürer, Le Nain, Ingres, Van Gogh, Cézanne, oui, tout […] excepté Picasso. »
Dans Les Papiers de Picasso, Rosalind Krauss réévalue la figure du Maître cubiste, du novateur, de l’inventeur, et le dévoile comme un être embarrassé et angoissé par le poids de son statut de génie créateur.
Elle convoque la psychanalyse pour relire les témoignages de ses proches, ses femmes, ses amis, et redessine une image de l’artiste, avec ses failles et ses doutes. Elle analyse aussi les rapports de Picasso avec ses contemporains, notamment Apollinaire, Cocteau ou encore Picabia, avec lequel le peintre entame un « bras de fer » aussi intellectuel qu’émotionnel.
En s’appuyant sur la linguistique et la sémiologie, Rosalind Krauss analyse brillamment les collages cubistes et les coupures de journaux choisies par Picasso, chacun révélant une multitude de voix, dont aucune n’est censurée par l’artiste, mais dont aucune n’est authentiquement la sienne.
Picasso est-il le Midas moderne qui aurait non seulement transformé les déchets de la vie quotidienne en or dans ses collages cubistes, mais aurait également conféré une nouvelle valeur au travail des Vieux Maîtres ? Ou était-il un contrefacteur vorace qui aurait impitoyablement puisé dans le style des autres ?
Rosalind Krauss, dans cet exercice novateur, démontre que Picasso possède sa propre formule dans l’art de pratiquer l’interdit.
Historienne de l’art, Rosalind Krauss enseigne à l’université de Columbia, à New York. En 1976, avec Annette Michelson, elle fonde la revue October.
Art et Culture
Clement Greenberg est le critique d’art américain le plus influent du XXe siècle – et ce livre, son maître-livre. Deux générations d’artistes et d’historiens de l’art moderne en ont tiré une manière de penser et, pour certains, de peindre et de sculpter. Toute la New York Scene s’est définie pour ou contre Greenberg – mais toujours par rapport à lui et des centaines d’articles polémiques lui ont été consacrés.
Qu’est-ce que l’art moderniste ? Qu’est-ce que le mainstream, de Manet à Pollock ? D’où vient l’explosion de l’art américain d’après-guerre ? À quoi tient l’importance de Monet et de Cézanne aujourd’hui ? Y a-t-il une spécificité de la sculpture contemporaine ? Faut-il préférer l’art abstrait ? Que vaut la peinture française depuis 1945 ? Kandinsky, Rouault, Soutine, Chagall sont-ils surfaits ? Le cubisme est-il la grande révolution artistique du siècle passé ?
C’est à ces questions que Greenberg répond dans Art et Culture : trente-huit articles – tous de circonstance – qui sont devenus autant de références pour la critique internationale.
Parfois rigide et partial, mais toujours passionné et provocant, Art et Culture est un livre irremplaçable.
Clement Greenberg (1909-1994) a collaboré régulièrement à Partisan Review, The Nation, The New York Times. Il a publié de nombreuses études dans les grandes revues d’art, et organisé quantité d’expositions. Parmi ses livres, un Juan Miró (1948) et un Matisse (1953).